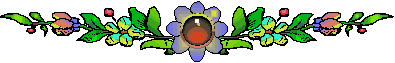
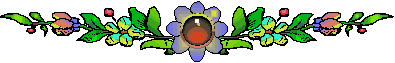
Le langage iconographique est constitué par
l'ensemble des éléments et des relations dont les combinaisons permettent de créer des images en donnant aux représentations des significations perceptibles et intelligibles.
Les signes qui composent ce langage reproduisent plus ou moins fidèlement les données de l'expérience visuelle.
Simplification, constance, répétition sont les caractères essentiels destinés à la communication.
L'image peut raconter des événements ou développer des idées, mettre en valeur un personnage ou montrer une scène,
figer un état ou animer une action. Les éléments, simples ou complexes sont les unités signifiantes du langage.
Un cercle, un arbre, une mitre, une main, un sceptre, un édifice peuvent être considérés comme des éléments d'une représentation.
Dans l'étude des enluminures en particulier, la relation entre l'image et le texte pose de nombreux problèmes.
On y trouve trois distinctions :
1) L'image est une réplique fidèle du texte, une transposition visuelle de l'expression verbale.
Les personnages, les objets et les actions sont figurés comme si l'imagier avait recopié l'écrit, mais avec des dessins au lieu des mots.
2) L'imagier présente les mêmes faits, les mêmes idées que l'écrivain mais sous une forme différente.
Il choisit, organise, interprète. Les Grandes Chroniques de France de St Denis constituent un ensemble typique homogène.
Elles partent d'un fait ou d'une suite de faits, présentés ou évoqués dans le texte, et raconte une histoire lon des formes qui ne doivent rien à l'écrit.
3) L'imagier interprète le texte au point d'exprimer des idées et de décrire des faits qui ne sont pas présentés dans l'écrit.
L'image et le texte.
Les enluminures sont plus précieuses que d'autres espèces de représentation pour l'établissement de la syntaxe iconographique, parce que l'image bénéficie du texte dans lequel elle est insérée.
La lettre historiée, en particulier, est inséparable de l'écrit avec lequel et pour lequel elle est crée.
Les images insérées dans les textes, les enluminures ou les représentations accompagnées d'inscriptions,
jouissent d'une lumière particulière, qui évite quantité d'erreurs dans leur interprétation. Le sujet est situé, l'identification des personnages ne pose pas de problèmes en général.
Le contexte d'une relation consiste en un ensemble de significations, générales ou particulières, qui ont une incidence sur la signification de cette relation.
Il en existe trois principales.
1) Le contexte thématique.
L'image est placée dans un contexte religieux, juridique, médical, littéraire, militaire ou autre et la signification de la relation prend des nuances et s'accorde avec le thème traité.
2) Le contexte événementiel.
Les particularités de certains sujets seraient incompréhensibles si on ne les situent pas dans le contexte historique et légendaire. Par exemple la tour de babel n'est pas une scène de construction comme les autres.
Dieu confond le langage des bâtisseurs qui ne peuvent réussir leur entreprise. Dans certaines représentations,les comportements des personnages s'expliquent par ce contexte.
3) Le contexte hiérarchique.
Le rang d'un personnage dans une hiérarchie peut intervenir comme facteur déterminant dans la signification de la relation.
Représentation en Etat et représentation en action.
La représentation en état et la représentation en action ont des significations différentes. Un caractère permanent ou éphémère, sérieux ou futile, bon ou mauvais, essentiel ou accidentel marque les comportements et leur donne
des valeurs qu'ils n'auraient pas sans cela. Le contexte seul permet d'apprécier la nature de ces significations associées et d'en mesurer l'importance.
;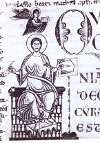 ; ;
; ;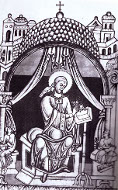 ;
;
Matthieu et son attribut St Grégoire
Dans le Légendaire de Cîteaux, les vies des saints commencent par des lettres historiées mettant en valeur la fonction principale du personnage et le titre qui lui a valu la sainteté. St Matthieu est représenté en train d'écrire
son Evangile. C'est du moins l'explication première que suggère l'image : il a dans la main droite un calame, juste au-dessus de la corne d'encre fixée sur son siège ; sa main gauche maintient ouvertes sur un lutrin, les feuilles sur lesquelles il écrit. En fait, cette interprétation sommaire est fausse.
St Matthieu est représenté en majesté, assis de face bien droit, le visage parfaitement régulier et impassible.
Son regard fixe n'est orienté vers aucun objet particulier. Cette position typique est incompatible avec quelque occupation que ce soit. La façon dont l'évangéliste présente son instrument et son livre exclut toute activité d'écriture.
Il serait donc abusif de chercher dans cette représentation des indications sur la façon d'écrire au Moyen Age, car la position et les gestes sont purement conventionnels. En revanche, cette image insiste sur le caractère inspiré de l'œuvre de l'évangéliste, au dessus duquel se tient, exactement dans son axe,
son attribut qui porte avec respect le livre, symbole de l'inspiration qui vient de Dieu.
La représentation de St Grégoire rédigeant sous l'inspiration de l 'Esprit est différente. L'auteur est en train d'écrire. Il tient l'encrier d'une main et le calame de l'autre. Son attention est concentrée sur ce qu'il fait.
L'imagier l'a figuré en action, mais sa composition exprime néanmoins des valeurs par un ensemble de relations conventionnelles.
Iconographie
L'inspiration divine est représentée par un oiseau soufflant à l'oreille. Blanc comme une colombe il descend du monde supérieur d'où il apporte son message. Il est aussi quelquefois posé sur l'épaule de l'écrivain.

La supériorité d'un être se reconnaît à ses attributs (couronne, mitre, auréole) ou à des relations comme la situation, la dimension et la position.
Les attributs des apôtres sont :
L'aigle de St Jean,
L'homme ailé de St Matthieu
Le taureau de St Luc
Le lion de St Marc
Le mauvais conseiller se place derrière celui auquel il murmure ses propos. Il le serre, lui pose la main sur l'épaule.
De profil, la bouche ouverte, il lui distille à l'oreille ses suggestions perfides et pernicieuses. Le diable n'agit pas autrement.

bon conseiller
Le bon conseiller, ne se place pas derrière, mais se tient à distance convenable, sur le côté ou l'avant. Il propose ouvertement ses avis.
La position assise est réservée à Dieu et aux personnages réels ou allégoriques, qui jouissent d'une supériorité hiérarchique et d'un pouvoir (roi, pape, juge, évêque). Le fait d'être assis sur un même banc, marque une égalité entre deux êtres.
La position agenouillée indique toujours une position de dépendance entre les personnes. C'est un signe d'humilité, de soumission.
Elle est inspirée par quatre finalités principales : l'adoration de Dieu ou du diable, la demande d'un bienfait, la pénitence et le respect dû à un supérieur. S'il agit d'une prière, le personnage est seul devant la divinité ou devant son autel.
La position couchée sur le côté, les yeux fermés est celle du dormeur qui rêve. La tête du personnage repose sur sa main ou son avant-bras.
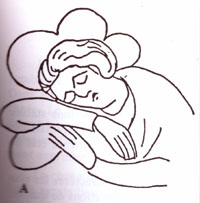
La position couchée sur le côté, les yeux ouverts peut marquer simplement le repos, celui du paresseux par exemple.
La position couchée sur le ventre. Allongé sur le sol, dans une prosternation, le personnage fait preuve d'une grande humilité devant celui dont il reconnaît et adore la transcendance.
S'il a fait une chute, sa posture ne laisse aucun doute sur sa position de vaincu.
La position couchée sur le dos, yeux ouverts est celle du malade ou de l'homme qui reçoit une apparition.
La position couchée sur le dos, yeux fermés, est celle de l'homme décédé. Cet état s'accompagne de deux positions principales des bras, qui pendent le long du corps ou sont ramenés sur le ventre.
La main et les doigts
La signification générale du doigt tendu est simple : il exprime une affirmation de la personne. Les autres doigts étant pliés, la main partiellement fermée, le doigt pointé est en effet le signe d'une pensée ou d'une volonté qui se propose ou s'impose. De nombreux facteurs précisent, modifient et nuancent cette signification :
- la condition, la situation et la position du personnage qui fait le geste
- le ou les doigts tendus
- l'orientation de la main
- l'orientation des doigts
- la présence ou non d'une personne ou d'un objet vers lequel le doigt est pointé.
La supériorité, l'égalité ou l'infériorité des personnages en présence modifie profondément le sens de leurs gestes.
Le doigt le plus souvent tendu seul est l'index. L'adjonction du majeur correspond à la qualité, la supériorité de celui qui l'accomplit.
Dieu, le pape, l'évêque ou le maître font souvent le geste de l'enseignement et de l'ordre avec deux doigts au lieu d'un roi ordonnant l'exécution d'un martyr.
roi ordonnant l'exécution d'un martyr enseignement